Pour une mise en contexte par rapport à l’histoire franco-américaine, consultez mon billet détaillant les grandes lignes de ce passé ou encore mon survol du parcours politique des « Francos ».
Il y a quelques années, il a été question ici même des gigantesques défilés de la fête de Saint Jean-Baptiste en Nouvelle-Angleterre à la fin du dix-neuvième siècle—époque à laquelle la population franco-américaine s’affirme et prend sa place dans les milieux urbains du Nord-Est. De telles célébrations demeurent pratique courante dans les premières décennies du vingtième siècle. Grand nombre d’associations et d’institutions franco-américaines vivent alors leur âge d’or par leurs adhérents autant que par leurs moyens d’action. Leur visibilité est manifeste et s’étend dans les sphères politique, culturelle et artistique, sportive, etc.
La crise économique de 1929 n’est pas sans séquelles dans l’organisation communautaire franco-américaine. Néanmoins, le type d’affirmation collective qu’on associe au 24 juin persiste. En 1937, par exemple, un grand défilé s’organise à Nashua, dans le New Hampshire. Le maire Alvin Lucier, lui-même franco-américain, mène la procession à travers les « tree streets », tout près des locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste et de l’usine qui aujourd’hui abrite les appartements Clocktower. Plus de 800 personnes participent activement au programme de la journée.
La Deuxième Guerre mondiale semble tout bouleverser, du moins si l’on s’en tient aux principaux ouvrages en histoire franco-américaine. La conscription force l’immersion culturelle des hommes; il en est autant des femmes qui travaillent dans les industries de guerre. La banlieusardisation qu’accélère le G. I. Bill contribue à l’effritement des Petits Canadas. Le fossé entre le Québec et les communautés nées de l’émigration aux États-Unis se creuse. Fort nombre de « baby boomers » grandissent sans connaissance personnelle du pays des ancêtres; ils vivent d’ailleurs les tentations d’une alléchante culture dominante étatsunienne à laquelle on ne peut échapper.
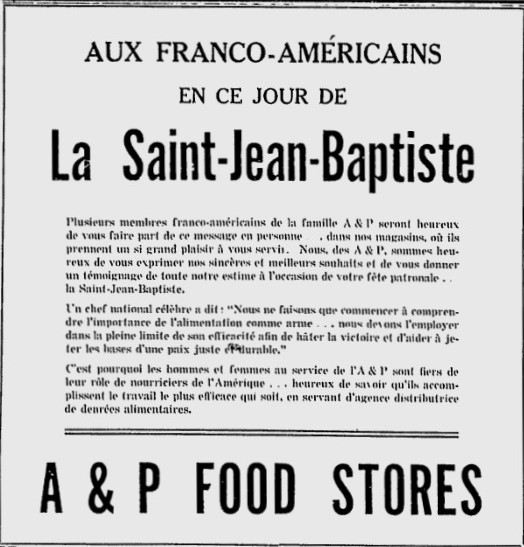
En réalité, l’intégration culturelle et économique de la population franco-américaine se produit peu à peu tout au long du vingtième siècle, plus tôt ou plus tardivement selon la famille et la communauté. Mais l’après-Deuxième Guerre mondiale représente un moment de transition. L’élite intellectuelle avance toujours l’idéologie de survivance et le réseau institutionnel demeure en bonne santé, or, l’activité communautaire se transforme et doit s’adapter à de nouvelles réalités sociales. Les événements qui ont lieu annuellement autour de la fête de Saint Jean-Baptiste expriment les espoirs et les inquiétudes de l’époque.
D’abord, le discours : Le Travailleur, publié à Worcester par Wilfrid Beaulieu, est l’exemple parfait de l’apostolat de la survivance qui se poursuit dans les années 1940 et 1950. Il saisit l’occasion, à chaque année, de rappeler ses lecteurs et lectrices à leurs valeurs traditionnelles. En 1945, il transmet les propos de Thomas-Marie Landry, O.P., curé de Fall River, partagés lors d’un banquet le 24 juin. Landry souligne alors trois anniversaires : le 75e de sa paroisse, le 60e du journal L’Indépendant de Fall River et le 25e de la Fédération catholique franco-américaine. Il déclare :
Un anniversaire, si l’on n’y prend pas garde, est un signe infaillible de vieillissement, pour les hommes et pour les institutions . . . Un des signes les plus évidents de vieillissement est le défaitisme! Et s’avouer vaincu d’avance, que ce soit dans vingt ou dans cent ans, c’est du défaitisme. Ici, les Franco-Américains ont à sauvegarder leur patrimoine religieux et culturel! Ils peuvent le faire, à condition de le vouloir. Le vouloir se manifeste par la ferme détermination à prendre tous les moyens d’action dont on dispose. Et nous avons pour grandir et prospérer la famille, la paroisse, l’école, la presse et dans une certaine mesure la radio, nos sociétés nationales.
Landry établit ainsi l’importance des institutions qui ont servi de piliers de la survivance. Puis, il insiste sur ce qui reste à accomplir, particulièrement par rapport au maintien de la langue française et des valeurs catholiques :
Tout n’est pas fini ici pour notre chère population franco-américaine : tout est à continuer et plus que jamais à revivifier, si nous ne voulons pas, en glissant vers les somnolences de l’inertie, arriver aux rivages et aux ombres de la mort . . . Soyons fidèles. Dans notre cas, Franco-Américains, l’avenir devrait être une projection parfaite de notre passé.
L’élite cléricale adhère à un traditionalisme qui ressemble à celui de Lionel Groulx au Québec—une culture qui doit se figer dans le temps et, avant tout, demeurer fidèle aux pratiques et aux idées des ancêtres.

À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste en 1946, Le Travailleur donne la parole à un autre prêtre en vue, Adrien Verrette, alors à Plymouth, dans le New Hampshire. Verrette rejoint Landry sur le fond. Il identifie deux écoles de pensée franco-américaines, dont « [l]’une – c’est la nôtre – veut continuer intégralement le travail des ancêtres ». Encore, on insiste sur la foi, instruite dans une « saine pédagogie chrétienne et catholique » et le maintien de la culture francophone. Ceci n’exclut pas un certain niveau d’intégration :
Et pour conserver et accomplir tout cela, ces Franco-Américains savent que leurs enfants et qu’eux-mêmes doivent très bien manier la langue officielle du pays; ils veulent que les leurs brillent sur tous les théâtres de la vie politique; ils désirent atteindre tous les sommets dans la vie intellectuelle, économique et sociale; ils aspirent même à tous les honneurs et les responsabilités de la vie catholique; ils veulent leurs écoles et institutions solidement fixées dans la tradition américaine.
Or, tout ceci doit se faire sans sacrifier l’héritage culturel canadien-français. Les gens qui offrent trop de concessions à cet égard appartiennent, selon Verrette, à l’autre école, « que nous appellerons volontiers capitularde ». Défaitisme, capitulation : à ce moment où la guerre est à peine terminée, ces termes représentent une brutale condamnation autant qu’un avertissement. Beaulieu, le rédacteur, applaudit le discours de Verrette, « qui cadre tellement bien avec nos vues ».
Voilà la ligne officielle dans les milieux intellectuels franco-américains, celle qui se fait entendre d’année en année. Ajoutons un autre élément qui complique ce qu’on pourrait croire être une parfaite unanimité. À Worcester, Beaulieu suit les traces d’Elphège Daignault, un pur et dur de la survivance qui, craignant l’américanisation, a mené une bruyante campagne contre l’évêque de Providence dans les années 1920. Cet assaut contre l’Église a valu à Daignault l’excommunication; le mouvement « sentinelliste » qu’il dirigeait a lutté ultimement en vain. Beaulieu n’est pas sans faire un tapage semblable dans l’après-Deuxième Guerre mondiale.
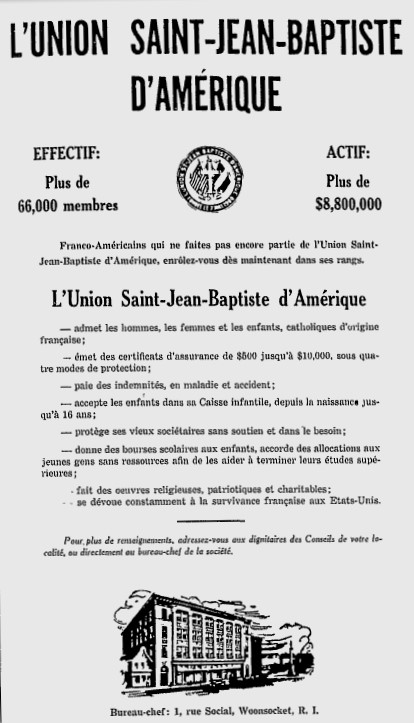
Pendant plusieurs mois, à partir de février 1948, Beaulieu signe une longue série d’articles intitulée « La trahison d’une communauté religieuse : les Pères Maristes ». Il dénonce les homélies prononcées en anglais dans les diverses paroisses nationales. Le ton qu’il emploie trahit sa méfiance à l’égard des structures ecclésiastiques. Il explique, le 19 février, que « les Pères Maristes viennent d’asséner à leurs ouailles franco-américaines un coup de matraque qui est bien de nature à déchainer dans tous les milieux franco-américains la plus belle querelle que nous n’ayons pas vue depuis l’affaire du Maine et le Mouvement Sentinelliste du Rhode Island. »
Beaulieu est prêt à prendre le relai de la supposée glorieuse cause de ses prédécesseurs. Ce goût de la lutte refait surface en 1951. Il s’en prend alors à l’évêque Matthew Brady de Manchester, qui se serait vanté du manque de résistance à l’anglicisation dans les paroisses franco-américaines. Beaulieu s’en prend au contrôle diocésain des orphelinats franco-américains du New Hampshire; à la nomination d’un curé anglophone à la cure de l’église Sainte-Marie, devenue St. Mary’s, de Claremont; et à la fondation de nouvelles paroisses territoriales et anglophones dans des communautés franco-américaines.
Cette croisade aurait sans doute gagné sa part d’adeptes trente ou quarante ans plus tôt. S’il y a consternation dans certains cercles, elle ne se traduit pas par un mouvement de masse dans l’après-guerre. L’heure n’est pas encore à la panique, puisqu’un fort nombre de paroisses persistent dans l’usage de la langue française et les écoles bilingues survivent. En même temps, des familles franco-américaines quittent l’ombre de leurs clochers ancestraux sans s’attendre à baigner dans le même univers francophone. Elles souhaitent assurer à leurs enfants le succès dans un milieu où l’anglais est dominant. Les activités de Beaulieu lui valent peu d’encouragements, que ce soit des gens ordinaires ou du clergé, qui craint l’embarras de cette campagne menée sans tact—et qui risque de se terminer comme le mouvement sentinelliste.
Le discours du Travailleur—de plus en plus isolé, compte tenu de la fermeture de journaux franco-américains—dissimule aisément le gouffre entre une élite qui demeure plus que jamais soudée aux valeurs traditionnelles de la survivance et une communauté qui n’a pas couru les collèges classiques du Québec. Les activités du 24 juin et les autres célébrations franco-américaines font état de cette séparation culturelle qui se fera discrètement, graduellement, en deuxième moitié du vingtième siècle.

Un événement marquant, célébré à Worcester non pas à la Saint-Jean-Baptiste mais en mai 1949, révèle les réussites et les occasions manquées. On souligne à ce moment « le centenaire franco-américain » : cent ans de vie commune aux États-Unis. Le choix de l’année est plutôt arbitraire. Le Devoir fait référence à des articles de la chroniqueuse Yvonne Le Maître, qui repère les premiers Canadiens français à Lowell en 1848. Le président de l’Association Canado-Américaine, Adolphe Robert, admettra dans un texte reproduit par Le Travailleur en juin 1949 que : « [l]e Comité d’Orientation a choisi l’année 1949 pour la célébration du centenaire franco-américain, non pas tant à cause d’un anniversaire particulier, que pour marquer un siècle de participation des nôtres à la vie américaine »[1].
À l’époque, on considère ce rassemblement comme étant le premier grand congrès franco-américain depuis 1901. Tel qu’alors, on adopte des résolutions et on organise un banquet riche en discours. Le sénateur Henry Cabot Lodge est présent, signe que les « Francos » ont bel et bien intégré le mainstream étatsunien dans l’imaginaire collectif sinon dans les faits. D’ailleurs, à cette époque, lorsqu’on discute de la patrie, même chez les apôtres de la survivance les plus dévoués, c’est maintenant aux États-Unis et non au Canada qu’on fait référence[2]. L’abbé Landry prend aussi la parole à ce congrès. Le panégyrique à la survivance a toujours sa place. C’est à ce moment qu’on forme le projet d’une fédération des organismes féminins franco-américains. La « Fédé » naîtra l’année suivante.
Le banquet du centenaire s’ouvre au public par une vente de billets; il attire des centaines de gens. Mais l’événement ne se traduit pas par des manifestations locales à travers les états du Nord-Est. Il n’entre pas dans l’espace public, que ce soit par un défilé ou par d’autres réjouissances à grande échelle. Est-ce les ambitions ou les moyens des organisateurs et organisatrices qu’on doit juger modestes? On ne peut ignorer le contraste entre les activités du centenaire et la Saint-Jean à Manchester le mois suivant. À ce moment, 20 000 personnes se présentent sur la rue Elm pour regarder le défilé traditionnel. Les activités incluent la consécration d’un monument public honorant Ferdinand Gagnon, né un siècle plus tôt et dont la carrière journalistique avait débuté à Manchester. Les consuls canadiens et français en Nouvelle-Angleterre se joignent à Josaphat Benoit, Eugène Jalbert, Wilfrid Mathieu et d’autres grandes pointures franco-américaines pour le dévoilement.

Les anniversaires dont Landry mettaient en garde ses compatriotes se poursuivent en 1950. En mai, un événement organisé par l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique (USJB), l’une des grandes mutuelles franco-américaines, célèbre son cinquantième anniversaire. Si quelques évêques canadiens se présentent, ce sont l’archevêque Richard Cushing de Boston qui donne la bénédiction et l’évêque John J. Wright de Worcester qui offre l’allocution d’ouverture du congrès de l’USJB. Le mois suivant, les « Francos » de Burlington, dans le Vermont, se réunissent pour souligner le centenaire de la première paroisse franco-américaine. Une messe célébrée par l’évêque précède un banquet auquel se joignent les principales personnalités politiques de l’endroit. L’année suivante, c’est au tour de la Société Saint-Jean-Baptiste de St. Albans, qui compte alors 700 membres, de se fêter. Cette société a alors cinquante ans. Un défilé marque l’occasion lors de la Saint-Jean-Baptiste.
Des événements semblables ont lieu dans le Maine. À Biddeford et à Lewiston, il y a toujours une messe et un banquet le dimanche le plus près du 24 juin. Par contre, l’envahissement des rues et des espaces publics par un défilé n’est pas une chose certaine, d’une année à l’autre. Il y a tout de même des moments forts : en 1955, une parade anime les rues entre le parc municipal (Kennedy Park) et l’église Sainte-Marie à Lewiston. Des visiteurs d’autres centres franco-américains (Rumford et Skowhegan, par exemple) viennent regarder le défilé, qui inclut neuf chars représentant surtout des associations paroissiales en plus des membres de l’Institut Jacques-Cartier, des Montagnards, des scouts, etc.
L’ère des défilés perdure, mais non sans inquiéter des leaders qui perçoivent un glissement par rapport à la reconnaissance publique de la fête patronale et de la culture franco-américaine. En juin 1956, Le Travailleur avoue qu’« [à] part Leominster, Mass., il me semble qu’on a tout à fait oublié [la Saint-Jean-Baptiste] dans le comté de Worcester! ». Les jeunes connaissent l’importance du 17 mars mais non du 24 juin, ce qui porte la rédaction à déclarer, « On ne sait plus qui l’on est!! ». Le journal renchérit en citant un article de L’Impartial qui déplore l’absence de célébrations à Nashua « encore une fois ».

Certes, dans la semaine précédente, il y a eu un défilé à Rochester, dans le New Hampshire, et un grand rassemblement à Manville, tout près de Woonsocket dans le Rhode Island. Manchester a reçu quelques dizaines de milliers de gens pour un défilé comprenant bon nombre d’associations. Or, ce dernier événement, qui coïncide avec la Saint-Jean, est explicitement une fête religieuse dédiée à la Vierge Marie. Wilfrid Beaulieu se plaint de l’érosion des réjouissances culturelles propres à la communauté franco-américaine : « La Saint-Jean-Baptiste… c’est trop franco! Une fête mariale… ça fait plus ‘universel’ ». La frustration du rédacteur est sans doute amplifiée par les défis financiers qu’il rencontre. D’un mois de juin à l’autre, dans les années 1950, il fait état de la détresse financière du Travailleur tout en cherchant à accroître les abonnements. Lors de son plaidoyer de 1956, c’est un déficit annuel de $3000 qu’il doit combler.
Ces défis ne sont pas uniques à ce journal. Le Rhode Island est déjà sans journal francophone à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale. La Justice cesse ses activités en 1949. Les quotidiens L’Étoile de Lowell et Le Messager de Lewiston deviennent des hebdomadaires avant de disparaître—le second en 1967, ce qui ne laisse que Le Travailleur. Celui-ci paraît jusqu’à la fin des années 1970. Nouvelle source d’information et de divertissement, la télévision y est pour quelque chose. Cette nouvelle ère de communications déplace d’ailleurs les ancrages culturels des Franco-Américains et des Franco-Américaines, facteur qui joue à long terme dans l’appui que pourrait offrir la jeune génération aux « vieilles » institutions de la survivance[3].
Ce bref survol du discours et des activités autour de la fête de Saint Jean-Baptiste en Nouvelle-Angleterre reflète un moment de transition qui annonce ce qui est depuis advenu. S’il faut se garder de juger après coup les jeunes gens qui s’identifiaient de moins en moins aux institutions culturelles de leurs aînés, il en est autant de l’élite intellectuelle qui adhérait à un culte des ancêtres ne répondant plus aux exigences modernes. Tout de même, nous pouvons reconnaître à cette époque un écart croissant entre le discours officiel et les pratiques culturelles dominantes—un écart qui précède la Deuxième Guerre mondiale mais qui s’approfondit et qui met en péril les vieilles institutions dans les années 1940, 1950 et 1960. Et si l’élite de l’époque ne croyait pas le déclin inévitable, nous devons les rejoindre et poser la grande question : qu’aurait-on pu faire différemment?

En ce début de vingt-et-unième siècle, pour bien des gens, il n’est plus question de simplement assurer la survie de la culture franco-américaine. On entend souvent que cette culture est sur le point de mourir et qu’il faut la sauver—un discours qui, d’abord, n’est pas de sorte à inviter les jeunes à s’y intéresser. Rarement soutient-on qu’il faut adapter. Le mot aurait sans doute été considéré une dangereuse concession par les Landry, Verrette et Beaulieu des années 1940. Et pourtant : c’est en adaptant une culture aux présentes conditions qu’on lui assure sa pertinence, son énergie et sa créativité. C’est de sorte à se demander ce à quoi ressemblerait la Saint-Jean-Baptiste aux États-Unis aujourd’hui si le culte des traditions avait pleinement rencontré les préoccupations de l’heure.
Sources
Ce billet a été rédigé à partir des numéros du Travailleur publiés à cette époque et numérisés sur la Google News Archive.
Autres publications :
- Telegraph [Nashua], 21 juin 1937.
- L’Impartial, 22 juin 1937 et 28 juin 1956.
- Daily Sun [Lewiston], 23 juin 1946 et 27 juin 1949.
- La Justice, 27 juin 1945, 26 juin 1946, 23 juin 1949 et 30 juin 1949.
- Le Devoir [Montréal], 30 mai 1950 et 23 juin 1950.
- Daily Messenger [St. Albans], 22 juin 1951.
- Sun Journal [Lewiston], 27 juin 1955.
[1] « Le journaliste qui sembla donner le plus grand effort personnel fut M. Antoine Clément, rédacteur à l’Etoile de Lowell. Créateur du terme ‘franco-américanie’, dès le 24 août 1948, M. Clément suggérait la tenue d’une pareille manifestation dans ‘Le Centenaire franco-américain’. » Voir La Vie franco-américaine : Centenaire Franco-Américain 1849-1949 ainsi que Le Devoir, 4 septembre 1948.
[2] Tout selon l’occasion, on reconnaît avec plus ou moins d’insistance l’importance d’un patriotisme américain. À la veille de la Saint-Jean-Baptiste, en 1949, La Justice de Biddeford publie un texte de La Liberté qui salue les sacrifices qui ont garanti aux « Francos » leur pleine américanité : « En ce jour de notre fête patronale patriotique, nous feuilletons de nouveau notre livret d’hypothèque national des États-Unis. Nos ancêtres firent le premier placement sur le bien que nous habitons aujourd’hui. Les générations payèrent sur le principal et rencontrèrent toujours avec honneur les échéances d’intérêt, en remplissant leurs devoirs civiques, par le service à la guerre comme par le travail dans l’industrie et les services publics ».
[3] Voir, à ce sujet, Paul Paré, « A History of Franco-American Journalism », dans A Franco-American Overview, Volume I (NADC, 1979).
Leave a Reply